L’art osé du matin #1 27/04/2020

Des lacets en barbelé
Comme tous les matins depuis quelques mois, je m’assieds dans mon fauteuil pour lacer mes chaussures. Avant, je me baissais mais les années sont lourdes sur mes reins et maintenant, je suis plus à l’aise en m’asseyant. Ce matin, je ne me sens pas comme les autres jours, un poids s’affirme sur mes épaules engourdies d’inquiétude. J’enfile mes chaussures et des larmes brouillent mon regard derrière mes lunettes de presbyte. J’hésite, je doute, je n’ai pas le droit de renoncer mais une suffocante envie de me faire porter pâle étreint ma gorge, la sueur glisse de mes tempes au bas de mon dos meurtri. J’ai l’impression que je vais me pisser dessus. Je souffle, je renifle, je ravale ma morve. Je suis perdu.
Je me penche sur mes lacets mais ils me font peur. Depuis quelques jours mes gros lacets cotonneux de chaussures de marche sont des barbelés. Si tu t’approches, tu te piques. Je rêve d’avoir 4 ans et de ne plus savoir faire mes lacets, on ne peut pas sortir quand ses lacets ne sont pas faits, hein Maman ? Mais j’ai cinquante de ces foutues années qui sont de plus en plus lourdes et je sais faire des lacets, même s’ils sont en barbelés. Alors je les tords en mordant mes lèvres pour ne pas hurler, ils me piquent les doigts, ravinent mes phalanges. Je dois y retourner. Je dois quitter les miens.
J’ai travaillé douze heures hier à l’hôpital, j’ai marché, couru, dans les couloirs de la mort et je suis rentré, épuisé, vidé, silencieux. Je ne raconte plus mes journées, elles sont si sombres que j’en préserve ma femme et mon fils. Ce matin, je suis le poilu qui rentrait hier de permission mais qui aujourd’hui, sent l’envie de désertion le prendre tout entier, irrémédiable. J’ai peur. Et si je me déchirais volontairement le doigt pour être exempté, comme des poilus offraient leur main à l’ennemi au dessus de la tranchée, espérant une balle qui briserait leur paume pour pouvoir rentrer chez eux ? La tranchée d’en face est trop occupée à panser ses propres plaies pour ouvrir la mienne, mes mains résistent aux barbelés.
Je me lève et je vois mon fils entourant la jambe de ma femme, leurs regards sont bas, les larmes aussi c’est contagieux. J’ai réparé le vélo de mon fils et sa voix lapidaire vibre dans mon corps fatigué « T’es mon héros, papa, et je ne veux pas prêter mon héros, sinon qui va me protéger ? » Des baisers plein de morve de pleurs sur ses mains potelées me sont envoyés comme si j’étais sur le pont du Titanic dans les brumes de Manchester. On ne s’embrasse plus parce que malgré mille précautions, on aurait pu en oublier une, on reste à distance. Moi qui m’inquiète à suffoquer de la santé de mon père, j’ai la rage qu’à 4 ans à peine, mon fils ait déjà si peur de ne plus me revoir. Mais c’est ma mission, mon amour.
J’ai toujours voulu être un héros, c’est ce que j’ai dit le jour de l’oral du concours. Mesdames et Messieurs du jury, je veux sauver le monde, je donnerais ma vie pour ça. Je suis au pied du monde aujourd’hui et je maudis ma vanité comme je maudis tous ces compliments maintes fois entendus. Tu es un type bien, dévoué aux autres. En regardant mon fils, j’exècre cet égoïsme qui me demandait de récolter des lauriers de reconnaissance. J’exècre cette générosité qui aujourd’hui me met en danger. Je ne dédaignerai plus les individualistes, j’ai l’impression que ce sont eux qui avaient tout compris.
Derrière la porte que je claque à reculons, comme si c’était la dernière fois, je pose un genou à terre, refoulant la nausée du retour de mon petit déjeuner avalé en deux secondes pour prendre des forces mais aucun plaisir. Ma tranchée sans boue me guide sur un chemin à sens unique, la marche arrière n’était pas incluse dans mon pack. En courant pour fuir le remords, je m’effondre de l’intérieur, je suis liquide, je suis la larme déferlante à moi tout seul, l’impitoyable tsunami. Je ne peux pas crier de crainte de réveiller ceux qui ne sont pas morts. Je me fais dedans.
Endetté jusqu’au cou pour un appartement situé à deux pas de mon travail, depuis ces quelques jours je déteste cette proximité qui m’amène trop vite sur le champ de bataille. Mes bottes de sept lieues sont des cuissardes de sept tonnes. Je vais bien finir par arriver mais en attendant, j’ai honte d’hésiter, j’ai honte d’avoir peur. Ces belles façades fermées inondées de soleil glacent mon sang, on ne sait plus si les âmes dorment de cette nuit ou pour l’éternité. Je crains le pire, je me méfie. Mes certitudes sonnent un glas amer, je ne suis plus rien, on n’est plus humain sans certitudes.
A regret, je suis arrivé à la porte de l’hôpital. J’ai eu raison du fil de la vie qui me tirait loin des miens, improbable élastique caramélisé par le temps, distendu et sans vigueur. Les lions m’attendent derrière le sas où on lave son corps des derniers doutes, antichambre où nous attendent nos intrinsèques certitudes. J’évite le miroir qui ne reflète que l’ombre de moi-même et me jette dans la fosse, résigné à être dévoré. Parce qu’il le faut. Ce matin encore, j’ai trouvé la force de hisser mes peurs jusqu’ici, parce qu’on ne la fait pas à un soignant dans l’âme. Ma conscience a encore entravé mes éternelles certitudes, je souris en mon for intérieur, apaisé. Je t’ai vaincu cette fois encore, essaie une autre fois…peut-être.
John Bodin
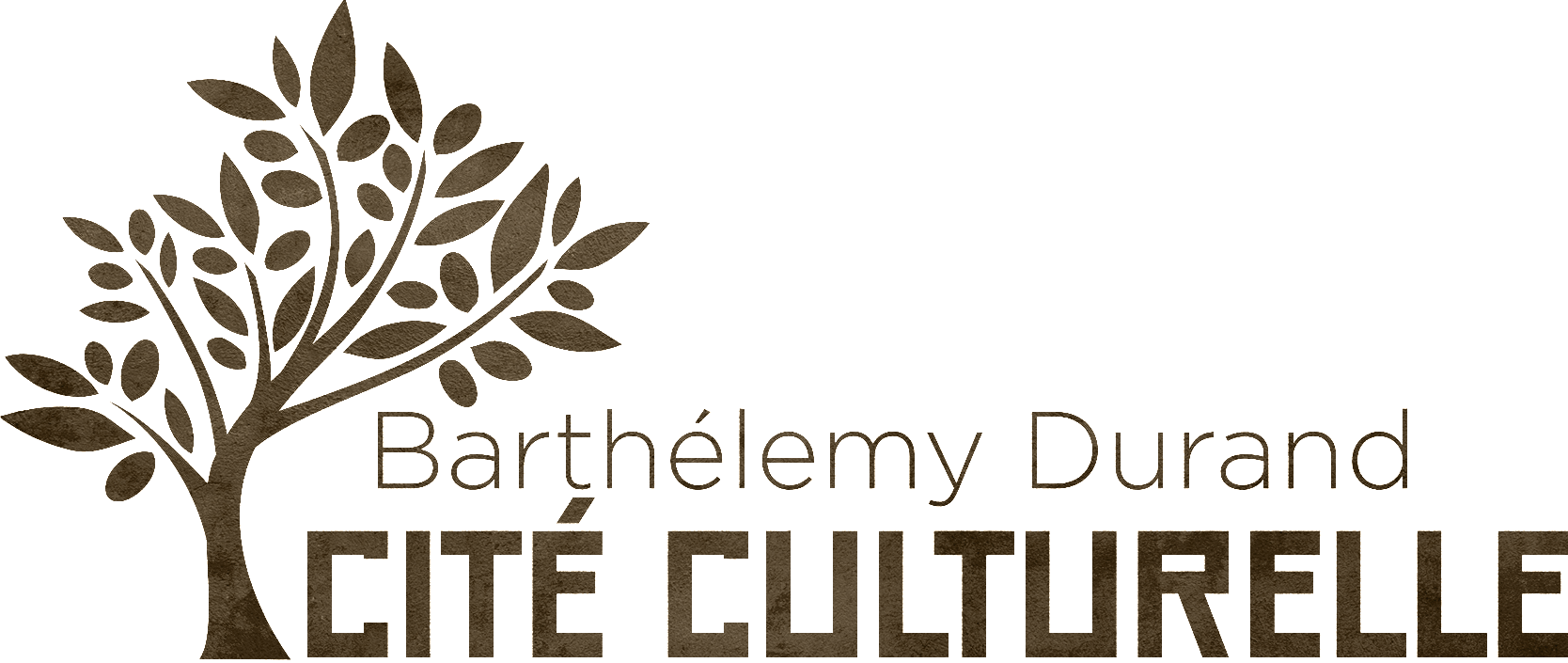




Un texte bouleversant et saisissant lié à l’autoportrait d’Otto Dix donne un ensemble poignant !
Bravo et merci !